La désindustrialisation de la France 1995-2015
par Nicolas DUFOURCQ, aux Éditions Odile Jacob
Olivier CHAMPAGNE, Managing Partner STRAPER, Membre du Comité Magazine
Bien que paru en 2022, il nous semblait intéressant d’évoquer cet ouvrage, dans le présent numéro du Magazine car il permet de mieux comprendre pourquoi aujourd’hui la réindustrialisation se justifie et nécessite de fait de très importants besoins de financement pour y arriver.
Lire Nicolas Dufourcq, c’est ouvrir, avec la sincérité et la neutralité de son auteur, les yeux sur un naufrage qui est analysé comme un réel drame pour le pays marqué par une espèce d’immense inconscience collective sous le joug d’évènements successifs, de politiques menées redoutables, tout ceci accompagné d’une incapacité ou le manque de volonté à retenir l’industrie sur le territoire national avec l’ouverture des hostilités dans les années 70 marquées par le premier choc pétrolier suivie par une accélération entre 1995 et 2015. Dans La désindustrialisation de la France (1995-2015), l’auteur – qui dirige Bpifrance depuis sa création en 2013, mais aussi fin connaisseur du monde économique – ne signe pas un simple essai, mais un travail de mémoire industrielle. À travers une galerie de témoignages, il interroge les vingt années au cours desquelles la France s’est vidée de la moitié de ses industries.
La période que Nicolas Dufourcq examine n’a rien d’anodin. Il dresse le portrait d’un pays qui, au fil des réformes, des aveuglements politiques et d’un certain mépris culturel envers le « monde de la production », a sacrifié son appareil industriel. À qui la faute ? À tout le monde, semble-t-il répondre, mais à personne en particulier.
L’une des originalités du livre est qu’il ne s’agit pas de théoriser les faits mais d’avoir recueilli 47 témoignages de PDG, de syndicalistes, de hauts fonctionnaires et d’économistes. Une sorte de grand procès-verbal national, où chacun livre son bout de vérité. On y croise des figures connues – Michel Pébereau, Jean-Claude Trichet, Xavier Fontanet – et d’autres moins célèbres mais tout aussi lucides. Leurs voix sont parfois dissonantes, souvent poignantes. Il y a dans ce chœur multiple une forme de résignation, parfois de colère froide, mais aussi des regrets : celui de n’avoir pas su anticiper, de n’avoir pas assez protégé ce qui faisait la force productive du pays. Nicolas Dufourcq insiste dans sa partie d’analyse sur la volonté d’ailleurs produire ailleurs pour soi-disant résister aux compétitions internationales et survivre.
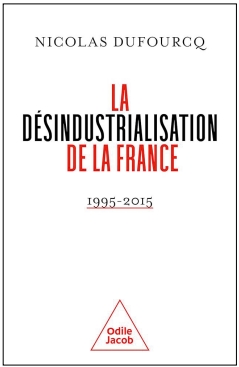
Ce qui frappe, c’est la lucidité rétrospective. Oui, la Chine a déferlé sur les marchés mondiaux. Oui, la monnaie unique a figé des déséquilibres que l’industrie a payés cash. Oui, la financiarisation de l’économie a détourné les grands groupes de leur vocation manufacturière. Et puis, ce mal français : La désindustrialisation de la France 1995-2015 par Nicolas DUFOURCQ, aux Éditions Odile Jacob Chronique Littéraire Juin 2025 - n°30 83 un rapport distant, presque honteux, au monde ouvrier, au « faire », à la machine, au sol. Là où d’autres pays, comme l’Allemagne, ont cultivé un capitalisme industriel, la France a longtemps misé sur les services, les idées, l’abstraction. Résultat : entre 1995 et 2015, ce sont plus de deux millions d’emplois industriels qui se sont envolés.
Mais le livre ne sombre jamais dans la lamentation stérile. Il y a, chez Nicolas Dufourcq, une forme de foi en la résilience industrielle. Ce n’est pas un réquisitoire, c’est une alerte. Il y a des passages où l’on sent poindre une certaine tendresse pour ces entrepreneurs tenaces, ces ouvriers debout dans des régions frappées par les fermetures d’usines, ces élus locaux qui ont tenté de retenir les emplois comme on retient l’eau dans ses mains.
Certains témoignages restent en mémoire. Celui de Jean-Claude Trichet, tout en rigueur monétaire, qui affirme que la compétitivité coût ne ment jamais. Celui de Xavier Fontanet, qui fustige un État-jockey trop lourd pour un cheval déjà boiteux. Et celui, plus modeste mais non moins essentiel, de syndicalistes comme Mohammed Oussedik ou Marcel Grignard, qui mettent en lumière la perte de savoir-faire, l’abandon des filières techniques, et la lente érosion de l’idéal industriel français. À travers eux, c’est tout un monde social qu’on entend parler : celui qui a vu les machines s’arrêter, les lumières s’éteindre dans les ateliers, et les territoires se vider.
Il ne faut pas chercher dans ce livre une thèse unique ou un programme clé en main. Ce n’est pas un manuel, c’est une exploration, un devoir de lucidité. Ce qui se dégage, en filigrane, c’est une conviction : la désindustrialisation n’est pas une fatalité. Elle fut une série de choix politiques, économiques, culturels. Elle peut donc être, sinon réparée, du moins combattue.
À l’heure où l’on reparle de « souveraineté industrielle », de relocalisations, d’autonomie stratégique, La désindustrialisation de la France agit comme un devoir de mémoire pour ne pas recommencer. L’ouvrage montre ce que nous avons laissé faire et nous invite, peut-être, à mieux réfléchir et agir pour la suite.

Olivier CHAMPAGNE
Managing Partner STRAPER,
Membre du Comité Magazine
